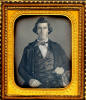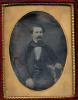à voir et revoir l'excellent documentaire de Stan Neumann : "Nadar, photographe"
le Musée d'Orsay, la SEPT-ARTE , les Films d'ici, Réunion des Musées Nationaux, 1994, 26'
 Gérard de Nerval
Gérard de Nerval

 Gérard de Nerval
Gérard de NervalCharles Baudelaire

photographie d'Étienne Carjat. 1861-62

Position réputée la plus commode pour avoir un joli portrait au daguerréotype.

photographie d'Étienne Carjat.
Honoré Daumier
La vie de Daumier (Marseille 1808 - Valmondois 1879) est une vie sans histoires : pas de péripéties romanesques, pas de voyages lointains. Mais il est au cœur de son époque qu’il a auscultée tout au long de sa carrière à l’aide de son crayon à lithographie. Il a vécu sous six régimes différents : l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire et la Troisième République et connu trois épisodes révolutionnaires (les trois Glorieuses, les journées insurrectionnelles de 1848, la Commune de Paris).
Daumier est le fils d’un vitrier (à la fois encadreur, réparateur de tableaux, dessinateur) marseillais qui part pour Paris en 1814 en vue d’embrasser une carrière littéraire qu’il abandonne en 1823. Honoré est d’abord commis puis il suit des cours de dessin auprès du peintre Alexandre Lenoir, travaille chez un lithographe et éditeur. En 1829, il collabore à La Silhouette, premier hebdomadaire satirique illustré en France, créé par Charles Philippon. Il publie ses premières caricatures de Louis-Philippe sous le nom de Rogelin. Gargantua, lithographie en noir et blanc est publiée dans la Caricature, n° 61, du 29 décembre 1831 et exposée dans la vitrine du journal, avant que la justice ne vienne saisir tous les exemplaires et briser la pierre lithographique. Gargantua lui vaudra une condamnation à six mois de prison et à une amende de 500 F "pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement". En 1832, les bustes-charges figurant les principaux représentants de la droite sont exposés dans la vitrine du journal Le Charivari de Philippon.
Daumier fait paraître ses charges politiques, notamment le Ventre législatif et Rue Transnonain dans l’Association lithographique mensuelle, supplément à la Caricature qui disparaîtra en 1835, suite à la loi contre la liberté de la presse. Daumier va alors s’en prendre aux mœurs de son temps et réaliser notamment la série des Cent et Un Robert Macaire.
En 1843, il publie quatre gravures dans l’édition Furne des œuvres de Balzac. Sa représentation du père Goriot sera reprise pour le frontispice de La Comédie humaine.
En 1845, il compose la série les Gens de justice.
Sa carrière de peintre commence en 1848 : sa toile La République nourrissant ses enfants et les instruisant est retenue parmi les vingt finalistes d’un concours de peinture. Des commandes officielles s’ensuivent, il participe au Salon avec Le Meunier, son fils et l’âne.
En 1851, il crée la statue de Ratapoil, personnage préfigurant le coup d’Etat de Louis-Napoléon. En 1853, Daumier se lie d’amitié avec les peintres de Barbizon, Camille Corot, Jean-François Millet et Théodore Rousseau.
En 1860, renvoyé du Charivari, il se consacre à la peinture et à la sculpture, mais n’arrive pas à en vivre. Il réintègre Le Charivari le 18 décembre 1963, s’installe à Valmondois en 1865, s’inspire de Don Quichotte dans ses tableaux, sa vue commence à baisser à partir de 1867. Il connaît des difficultés financières, Corot achète sa maison et la lui prête à vie.
En 1871, il publie des lithographies particulièrement sombres sur la guerre de 1870 et s’oppose à la proposition de Courbet d’abattre la colonne Vendôme. Il publie ses dernières lithographies dans Le Charivari en 1872. En avril 1878, une rétrospective de ses œuvres est organisée par la galerie Durand-Ruel et présidée par Victor Hugo. Elle connaît un succès critique mais pas public. Complètement aveugle, Daumier n’y assiste pas. Il meurt l’année suivante.

En 1851, Baldus, Bayard, Le Gray, Le Secq et Mestral parcourent la France afin de « recueillir des dessins photographiques d’un certain nombre d’édifices historiques ». De Reims à Bordeaux, de Strasbourg au Puy, de Fontainebleau à Nîmes, ils photographient, chacun selon sa sensibilité, les églises, les théâtres antiques, les châteaux qui, pour beaucoup, ont souffert sous la Révolution et menacent ruine. Cet épisode mythique est aujourd’hui désigné sous le terme de Mission héliographique, première commande publique collective de l’histoire de la photographie. La commission des Monuments historiques, animée par Prosper Mérimée, qui est à l’origine de cette aventure, a sélectionné les photographes et leur a acheté 258 épreuves (avec les négatifs correspondants), longtemps oubliées, récemment redécouvertes. Pour Mérimée et son équipe, il s’agit de documenter des édifices avant restauration à une époque où la notion de patrimoine est encore fragile.
 Le Gray
Le Gray


est un scientifique britannique, devenu l’un des pionniers de la photographie. Il était à la fois mathématicien, physicien et philologue ; également intéressé par la botanique, la philosophie et l’archéologie, il pratiquait plusieurs langues.
Talbot commença à s'intéresser aux images obtenues avec une chambre noire en 1833. Il est l’inventeur du calotype, ou talbotype, qu'il breveta en 1841. Ce procédé photographique permettait d’obtenir de multiples images positives sur papier à partir d'un seul négatif papier. Talbot mena ses recherches en parallèle avec celles de Daguerre. Après l’annonce de l’invention du daguerréotype en 1839, il tenta de faire reconnaître l’antériorité de ses travaux. Il n’y parvint pas mais son procédé du négatif-positif devint la base de la photographie argentique moderne.
Il fut lauréat de la Royal Medal en 1838 pour ses travaux sur le calcul des intégrales.
Talbot fut également l’auteur du premier livre illustré de photographies, Pencil of Nature (Le Crayon de la nature), paru en 1844.

Premiers essais photographiques
En 1833, lors d’un séjour au lac de Côme en Italie, Talbot tenta de reproduire des paysages en s’aidant d’une camera lucida, ou chambre claire, pour tracer des esquisses. Mais cette technique supposait de dessiner, ce qu’il n’appréciait pas. Il chercha alors à obtenir des images durables par un autre moyen et débuta ses expériences photographiques.
Son premier procédé s’appelait « dessin photogénique » (photogenic drawings) qu'il met au point en 18391. Il consistait à placer un objet sur une feuille de papier sensibilisée, puis à exposer le tout à la lumière, avant de fixer l'image obtenue. La silhouette de l'objet - feuille d’arbre, plante, plume, dentelle... - apparaissait en négatif. Le support photosensible était fabriqué en mouillant une feuille de papier dans une solution de sel de cuisine, puis de nitrate d'argent. Après l’exposition, l’image était fixée avec un sel de potassium.

Talbot poursuivit ses essais en utilisant la camera obscura, ou chambre noire. Il se servait de chambres de petite taille, appelées « souricières » par sa famille. En 1835, il obtint le premier négatif sur papier qui nous soit parvenu. Cette petite image négative de 2,5 cm de côté représente une fenêtre, prise de l’intérieur de Lacock Abbey, sa résidence dans le Wiltshire.
L’invention du calotype
En janvier 1839, l'invention du daguerréotype par Jacques Daguerre, à partir des travaux de Nicéphore Niépce, fut publiquement révélée en France. François Arago en fit l’annonce à l’Académie des sciences le 7 janvier. Cette nouvelle surprit Talbot, qui chercha alors à faire reconnaître l’antériorité de ses recherches. Il écrivit à Arago et envoya ses dessins photogéniques à la Royal Society de Londres. Le 31 janvier 1839, il fit une communication à la Royal Society sur le sujet (« Some account of the art of photogenic drawing, or the process by which natural objects may be made delineate themselves without the aid of the artists pencils »). Mais le daguerréotype était au point, bénéficiait du soutien de l’État français, et était disponible gratuitement : ce procédé allait s’imposer au niveau mondial pendant au moins une décennie.
Durant les années 1839-1841, Talbot améliora son procédé. Il réduisit le temps de pose par un traitement à l’acide gallique après l’exposition en chambre noire, ce qui permettait de développer l’image latente. Il repris la technique du fixage photographique à l’hyposulfite de soude qu’il avait apprise de Sir John Herschel. L’hyposulfite de soude, ou thiosulfate de sodium, possède la propriété de dissoudre les sels d’argent. Ce produit est encore utilisé aujourd’hui comme fixateur en photographie argentique.

Mais surtout, Talbot eut l’idée de se servir du négatif sur papier comme d’un objet à copier. Le tirage contact à partir du négatif papier permettait d’obtenir une image positive en autant d’exemplaires que souhaité. Son procédé surpassait en cela celui de Daguerre, car chaque daguerréotype est unique et ne peut être reproduit. En 1841, il breveta son invention sous le nom de calotype (appelé aussi talbotype).
En 1842, Talbot reçut la médaille Rumford de la Royal Society pour ses travaux novateurs dans le domaine de la photographie.
En 1844, il publia Pencil of Nature, le premier livre illustré avec des photographies jamais édité. Cet ouvrage relatait ses découvertes et comportait vingt-quatre calotypes hors texte.
Talbot apporta une avancée fondamentale à la photographie : la possibilité de reproduire une image positive à partir d’un négatif. Cependant, le calotype ne rencontra pas le succès mérité, car, d'une part, il donnait des images de moins bonne qualité que le daguerréotype et, d'autre part, il était breveté et soumis à des droits d'utilisation élevés, ce qui fut source de procès et entrava sa diffusion.




Le daguerréotype est un procédé uniquement positif ne permettant aucune reproduction de l'image. Il est constitué d'une plaque, généralement en cuivre, recouverte d'une couche d'argent. Cette plaque est sensibilisée à la lumière en l'exposant à des vapeurs d'iode qui, en se combinant à l'argent, produisent de l'iodure d'argent photosensible. Lorsqu'elle est exposée à la lumière, la plaque enregistre une image invisible, dite « image latente ». Le temps d'exposition est d'environ vingt à trente minutes, beaucoup moins que les méthodes précédentes qui nécessitaient plusieurs heures d'exposition.
Le développement de l'image est effectué en plaçant la plaque exposée au-dessus d'un récipient de mercure légèrement chauffé (75 °C). La vapeur du mercure se condense sur la plaque et se combine à l'iodure d'argent en formant un amalgame uniquement aux endroits où la lumière a agi proportionnellement à l'intensité de celle-ci. L'image ainsi produite est très fragile et peut être enlevée en chauffant la plaque, ce qui produit l'évaporation du mercure de l'amalgame.
 Le boulevard du Temple à Paris, vers 1838.
Le boulevard du Temple à Paris, vers 1838.